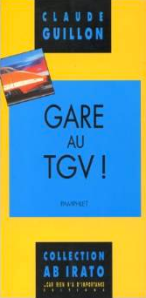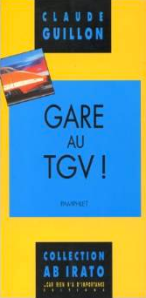
Je donne ici la troisième et dernière partie (sans compter les annexes) du texte publié en volume en 1993 sous le titre Gare au TGV ! (Éditions Car rien n’a d’importance…), aujourd’hui épuisé.
Je me souviens d’un slogan d’extrême-gauche de l’après-68 : « On ne vous transporte pas, on vous roule ». La SNCF semble avoir à cœur d’illustrer à la lettre cette formule, tant il est devenu difficile d’être simplement transporté. On nous affirme que le train à grande vitesse nous emmène à destination plus vite que par le passé. Cette abstraction dissimule un triple mensonge : les trains rapides ne desservent plus les mêmes gares, les horaires TGV n’offrent plus les mêmes possibilités, les tarifs ont subi des augmentations considérables.
Henri Vincenot rapporte le mot d’un ingénieur SNCF qui pestait contre les voyageurs sans lesquels « on ferait du bon chemin de fer[1] ». Il paraît que le ressentiment qu’entretient la SNCF à l’égard de sa clientèle n’a fait qu’augmenter avec le temps, au point que les mesures prises relèvent parfois de la guerre d’usure.
La première des libertés supprimées par le système TGV, c’est celle de sauter dans un train ou dans un autre, au gré de ma fantaisie ou pour faire face à une obligation imprévue. Aujourd’hui, le cauchemar des réservations obligatoires rapproche effectivement le TGV de l’avion, dans ce qu’il a de plus déplaisant : le temps perdu en démarches, téléphoniques d’abord (quasi impossibles et d’ailleurs il s’agit de contraindre à l’emploi du minitel [aujourd’hui d’Internet]), auprès d’un guichet ensuite. Il va de soi que ce temps n’est jamais comptabilisé par la SNCF dans les temps de trajet qu’elle affiche triomphalement.
D’abord testé sur le réseau Atlantique, le système RESA fut étendu au Sud-Est. Il imposait au voyageur de se présenter au moins une demi-heure avant le départ du train (ou l’avant-veille selon le cas) pour retirer, en plus du billet, une attestation de réservation, préalablement effectuée par téléphone ou minitel. En fait, il est préférable, surtout en période de grands départs, d’acheter ses billets à l’avance, ce qui suppose deux déplacements au lieu d’un. Qui choisit de se présenter directement à la gare doit y arriver très largement avant l’heure du départ en additionnant 30 minutes d’attente devant les guichets pris d’assaut aux 30 minutes obligatoires.
Ces contraintes absurdes, que la SNCF était bien incapable de gérer, entraînèrent tout naturellement des mouvements de colère, organisée ou spontanée, de la part des usagers. La pratique massive des réservations « de précaution » (sur trois trains successifs par exemple) suffit à désorganiser un système fragile, s’appliquant de surcroît à des trains d’une capacité très inférieure à celle des Corails (485 places contre 1 000 à 1 200 dans un Corail) donc très vite remplis, réellement ou par anticipation[2].
La SNCF réussit le prodige de dresser contre elle ses clients fétiches : les cadres. En décembre 1990, elle dut consentir, sous la pression d’une Association des voyageurs usagers du chemin de fer (AVUC), à étendre la validité d’une réservation aux trains précédents et suivants, dans un délai d’une heure[3]. L’AVUC étant basée à Lyon, cette tolérance est limitée au réseau Sud-Est ! Fin 1989, les Manceaux titulaires d’un abonnement mensuel avaient obtenu, en contrepartie de la nouvelle augmentation de 80 %, la gratuité pour vingt réservations par mois. Pareillement, la région Franche-Comté a obtenu le libre accès aux rames TGV sans réservation ni supplément, pour les seuls abonnés qui en feront la demande42. Il y avait eu des précédents ; ainsi, au milieu des années 70, le Comité de défense de la desserte ferroviaire de Quimperlé obtint la suppression des suppléments « trains rapides » dans toute la Bretagne. Comme bien on pense, la SNCF s’abstint d’étendre la mesure à des régions où elle ne lui était pas imposée par les usagers. Elle est restée fidèle depuis à cette stratégie du « particularisme régional ».
Ce que le président de la SNCF Jacques Fournier nomme avec délicatesse le « nuancement temporel des tarifs » aboutit fort prosaïquement à des hausses de 6 à 47 % suivant les trains, pour ne rien dire des abonnements déjà évoqués. Les contrôleurs, rebaptisés dans le goût du jour « agents commerciaux », s’employèrent à encaisser des amendes, elles-mêmes majorées. « Comme Mac Donald’s, qui a valorisé ses hamburgers en normalisant les gestes et les attitudes de son personnel, déclarait J.-M. Metzler, directeur commercial SNCF, nous devons mettre au point des procédures qui évitent l’improvisation et permettent à l’agent d’avoir l’esprit libre pour mieux traiter le client[4]. » Le rapprochement idéologique entre TGV et fast-food est tout à fait éclairant quant à l’état d’esprit des publicitaires SNCF, comme l’est la référence à une entreprise américaine connue pour pratiquer un encadrement flicard et moraliste de son personnel. Autres champions de la catégorie, les gérants d’Euro Disney peuvent se vanter d’avoir obtenu une excellente desserte TGV par la gare de Marne-la-Vallée. « De Londres, Madrid, Rome, elle accueillera ceux qui viendront oublier un moment le temps présent, rêver, être ailleurs » s’extasient les deux architectes SNCF responsables du projet[5].
Le temps est relatif à l’horaire
« La substitution entraîne brutalement et sans contrepartie la suppression d’un retour direct de Paris pour l’ensemble des villes, la disparition de toute possibilité de retour de Paris pour les petites, et l’impossibilité d’un retour du soir de la capitale régionale[6]. » Ce bilan, établi pour la Franche-Comté, pourrait être élargi et décliné selon les régions atteintes par le TGV. Aussi insupportable que cela puisse être aux amateurs d’infinis espaces, ferroviaires ou théoriques, j’ai pris le parti de fournir des exemples précis, de citer par le menu des témoignages qui montrent que le TGV a rendu impossibles, plus pénibles, plus coûteux, et parfois plus longs, de multiples déplacements, y compris au départ de Paris.
1 — De mai à septembre 1989, sur la ligne Atlantique, le dernier train pour Le Croisic[7] quittait Paris à 19 h 22 pour arriver à destination à 0 h 01, soit un voyage de 4 h 39 mn. Après la mise en service du TGV, il était impossible, cinq jours par semaine, de quitter Paris après 18 h 40. Compte tenu des 30 minutes imposées par le système RESA et de l’encombrement des guichets, il était donc impossible aux salariés travaillant ailleurs que dans les bureaux de la tour Montparnasse de rallier la gare à temps après une journée de travail.
Encore s’agissait-il d’aller au Croisic, c’est-à-dire au terminus de la ligne. Malheur à qui eût voulu, par exemple, descendre à la station précédente, Batz-sur-Mer. Avant le TGV, le Corail de 19 h 22 ralliait cette localité de la presqu’île Guérandaise en 4 h 35 mn. En septembre 1990, le voyageur devait emprunter le « TGV » de 18 h 40 jusqu’à Nantes, où il devait attendre 1 h 25 mn avant de repartir par un omnibus qui l’amenait à Batz à 23 h 13. Son voyage avait donc duré 4 h 32 mn, soit un gain de 3 minutes par rapport au trajet en Corail ! Coût de ce petit miracle de la technique moderne : rupture de charge et attente à Nantes, seconde partie du voyage souvent effectuée dans un matériel vétuste, malgré une réservation de 32 à 80 F selon les jours.
L’escroquerie est d’autant plus manifeste qu’en fin de trajet, à partir de la gare du Pouliguen, la voie unique traverse un paysage de marais salants qui fait le charme du pays, mais interdit la grande vitesse pour des raisons techniques. Comme sur les voies de la Bretagne intérieure, le « TGV » roule donc à la même vitesse qu’un Corail ; il brûle néanmoins la gare de Batz, à 4 minutes du terminus !
Il est vrai que la direction commerciale de la SNCF développe d’étranges théories : « On estime (sic) que sur 4 heures de trajet, un gain de temps de 5 à 6 minutes peut faire gagner 3 % du trafic[8]. » Autrement dit, moins les usagers habituels du train peuvent se rendre là où ils allaient auparavant et plus nombreux seront les usagers du train. On rapprochera utilement ce sophisme d’un mouvement d’humeur du ministre des transports Le Theule précisant en 1979 (déjà !) que « ce n’est pas parce que, dès l’origine et jusqu’à une époque récente, le transport par fer a été considéré comme un service public parce qu’il était le seul mode de transport, que cette notion doit se perpétuer[9] ». Dix ans plus tard, la SNCF peut donc — grâce au TGV — rompre avec l’idée d’un « service » dû au « public », entité indéterminée autant qu’imprévisible dans ses comportements. Elle offre désormais en priorité des « produits », destinés à une clientèle « ciblée » qu’elle espère détourner de l’avion. Le relatif succès commercial du TGV, malgré les impairs évoqués plus haut, montre qu’à condition de ne considérer que les grands trajets le calcul n’est pas faux.
— Un Rochelais, lecteur de La Vie du Rail (1er au 7 novembre 1990) tient à se présenter comme « fils de cheminot, passionné de choses ferroviaires » avant de décrire les dégradations du service consécutives à la mise en service du TGV Paris – Bordeaux : « l’année dernière [en 1989], ma fille pouvait le samedi à l’issue de ses cours, quitter Tours à 12 h 56 et arriver à La Rochelle à 15 h 38. Durée du trajet : 2 heures 42 minutes, y compris les deux changements à Saint-Pierre-des-Corps et Poitiers. L’heure d’arrivée laissait la possibilité d’une activité familiale en fin d’après-midi. Désormais (…) cette possibilité n’existe plus. Elle peut certes prendre à Saint-Pierre-des-Corps un TGV à 14 h 53 et, après changement à Poitiers, arriver à La Rochelle à 17 h 29. D’où il résulte que l’après-midi est « fichue ». Bien mieux, compte tenu du fait qu’elle doit prendre à Tours une navette dont l’heure de départ se situe aux alentours de 14 h 43, la durée du trajet, changement compris, est donc de 2 heures et 46 minutes. C’est plus long, et c’est plus cher. (…) Il y aurait de façon plus générale, beaucoup à dire, sur la quasi-disparition des trains directs La Rochelle – Paris. Les rares “survivants’’ ne sont même pas mentionnés comme trains Corail. Est-ce parce cela va de soi, ou bien, parce qu’ils bénéficieront de ces splendides DEV Inox où sans vergogne, la SNCF ose entasser 88 personnes, affirmant sans rire que l’espace gagné par la suppression des cloisons des compartiments permet le “gain’’ de 16 places ! »
— Sous le titre « Le TGV fait dérailler les navettes », le Courrier de la presqu’île guérandaise (3 août 1990) publie le témoignage d’un habitant de Versailles possédant une résidence secondaire au Pouliguen (Loire-Atlantique) : « J’étais un fervent adepte des trains de nuit pendant la période des vacances d’été : départ le vendredi soir de Paris, arrivée le samedi matin au Pouliguen, et retour vers Versailles le dimanche soir pour arriver le lundi matin. [Le train de nuit supprimé, reste] un TGV le vendredi à 19 h, ce qui est bien évidemment trop tôt, ou le samedi matin seulement. Pour le retour, le dernier TGV part en début de soirée ou bien l’on ne peut arriver à Paris qu’en fin de matinée de lundi. (…) Le lundi matin, je dois me faire conduire à Saint-Nazaire (25 km) afin de prendre un TGV à 5 h 56. (…) De même, pour venir en fin de semaine, je dois attendre plus de 2 heures en gare de Savenay à 3 h du matin (train Paris–Quimper) avant de prendre le premier train pour Le Pouliguen. Je ne me fais aucune illusion, ce train de nuit vers Quimper sera certainement supprimé dès la mise en service du tronçon TGV Rennes–Quimper. »
— J’ai, au début de cet ouvrage, opposé la SNCF aux nucléocrates quant à leurs capacités respectives d’idéologues ; il est cependant un point sur lequel tous ces gens se rejoignent : la manie de la dissimulation.
Consulter les horaires et destinations d’un train peut apparaître au naïf chose élémentaire et pour tout dire légitime. Il en allait ainsi, sans doute, avant que la SNCF ne s’avise qu’un train dont l’horaire est intempestivement porté à la connaissance du public risque d’attirer à lui des voyageurs qui pourraient bien quelque jour s’offusquer de sa suppression. Le Comité de défense de la desserte ferroviaire de Redon (Ille-et-Vilaine) obtint en 1990, après avoir bloqué plusieurs dizaines de trains, deux arrêts quotidiens d’express, l’un en direction de Quimper, l’autre de Paris. La SNCF s’abstint de les faire figurer sur les fiches horaires, sur le minitel, comme sur les tableaux d’affichage parisiens. Ni les employés de gare ni les contrôleurs n’avaient été informés de leur existence. Le Comité fit constater ces carences par huissier.
De son côté, la direction régionale de la SNCF jugeait la chose bien simple : le principe de quatre arrêts “TGV” étant acquis pour Redon (après moult escarmouches), un seul d’entre eux était définitivement fixé en milieu d’après-midi, « on ne peut donc, déclarait le responsable, officialiser ceux de 10 h 18 et 20 h 09 sur ces deux pré-TGV[10] ».
On goûtera à sa juste valeur l’emploi du verbe « officialiser » ! De même, le concept pompeux de « pré-TGV », dont la SNCF a fait grand usage en Bretagne, mérite-t-il une mention particulière. On se souvient en effet, qu’à Redon comme dans toute la Bretagne, les « TGV » roulent à la même allure que les trains classiques. Le « pré-TGV » est donc, tout comme sera le futur « TGV », un train ordinaire dont seule est extraordinaire l’obstination à ne s’arrêter nulle part. Pour les deux express faisant halte en gare de Redon, sous la pression toute officieuse du populaire, c’était encore trop. La SNCF entendait bonnement faire d’eux des trains fantômes, dont il eût été plus aisé de faire constater par la suite, par voie d’huissier si nécessaire, que — personne ne les empruntant — ils pouvaient sans dommage rentrer tout à fait dans le néant. L’expérience de vingt ans des associations de voyageurs montre qu’un train que la SNCF dissimule à sa clientèle est toujours un train condamné.
Il arrive même fréquemment qu’ayant supprimé les arrêts et fermé la gare, la SNCF pousse la précaution jusqu’à en faire raser le bâtiment. Sans doute cela permet-il d’acquitter moins d’impôts locaux, mais il s’agit surtout de faire disparaître physiquement un vestige auquel restent attachés tant de souvenirs qu’il risque à tout moment de cristalliser de nouvelles revendications. On peut rouvrir une gare, pas un terrain vague.
— Ignorant ses propres ridicules, la SNCF sait se plier à ceux des autres. Je la soupçonnerais volontiers d’y mettre quelque gourmandise lorsque les incohérences des politiques nuisent aux seuls voyageurs sans gêner ses affaires. Le Canard Enchaîné (31 juillet 1991) révélait ainsi une jolie farce ferroviaire : le conseil régional de Basse-Normandie, contraint par la dite décentralisation de subventionner le Corail Paris–Granville de 16 h 35, obtint de la SNCF que — malgré un arrêt quotidien à Dreux — les voyageurs à destination de cette ville aient l’interdiction d’emprunter « son » train, sous peine d’amende. Le conseil de la région Centre, où se trouve Dreux, n’avait pas payé son écot… Les voyageurs doivent donc en principe attendre le train suivant, une demi-heure plus tard !
On voit que la rationalité financière moderne, qui sert ailleurs à justifier licenciements et fermetures, sait aussi s’accommoder des délicieux anachronismes du clientélisme maffieu.
L’automobile, handicap moteur
Il y a déjà beau temps que la SNCF considère le rail comme un complément de la route. Son président J. Pélissier déclarait en 1979 : « Nous n’abandonnons pas la desserte des petites gares. Il faut tout de même admettre que nous ne sommes plus au temps de la carriole à cheval. Les gens se rendent à la gare en véhicule automobile[11]. » À peu près à la même époque, son directeur régional expliquait sérieusement aux habitants d’Hennebont (Morbihan) qui se plaignaient de voir leur gare progressivement désaffectée : « la gare d’Hennebont se situe seulement à 8 kilomètres de celle de Lorient où tous les trains s’arrêtent, ce qui relève d’une situation privilégiée[12]. » En fallait-il du mauvais esprit pour refuser l’évidence de ce privilège d’une gare où les trains s’arrêtent, et avec ça distante de seulement 8 kilomètres ! J’irai plus loin, les Hennebontais ont bénéficié avec dix ans d’avance, hélas sans savoir l’apprécier, d’une situation « pré-TGV » !
En 1990, la SNCF prétend bien, à propos du TGV Méditerranée, que « les déplacements effectués aujourd’hui en voiture particulière sur route et autoroute verront leur croissance ralentie[13] », mais il est clair que c’est la clientèle des compagnies aériennes qu’elle espère capter. Les opposants au TGV Méditerranée sont d’ailleurs bien conscients qu’une ligne nouvelle ne leur épargnera pas, à terme, la construction de nouvelles autoroutes.
À l’occasion de la publication, en septembre 1991, du budget de la SNCF, Le Monde écrivait naïvement : « Il semble que le train pâtisse de la concurrence de la voiture individuelle pour les voyages de moins de 100 kilomètres. Par exemple, les trains régionaux bretons enregistrent, cette année, une baisse de fréquentation de 10 % par rapport à 1990. L’amélioration du réseau routier en voie express n’y serait pas étranger[14]. » Et le TGV non plus ! qui a achevé de désorganiser le réseau régional, contraignant les habitants à trouver des solutions impliquant l’automobile. Mais la SNCF n’a pas suggéré cette hypothèse au journaliste…
En revanche, M. Metzler — l’homme aux hamburgers — lui propose un peu plus loin une analyse cocasse de la désertification des campagnes : « Si des zones entières se dépeuplent, c’est à cause de la voiture individuelle. » Cette révélation s’éclaire dans la suite : « Il n’y a pas de raison que le chemin de fer soit le dernier à quitter un pays déjà déserté par le percepteur, le curé et l’instituteur ! » On croit comprendre que ces lâches ont fui le pays en voiture… Comme si leur présence, hélas encore trop répandue, suffisait à faire s’arrêter un « TGV » !
Trêve de plaisanterie, le directeur commercial tente simplement d’exonérer la SNCF de sa part de responsabilité dans la désertification, quitte à désigner comme coupable le moyen de transport dont il attend qu’il amène aux gares « privilégiées » les usagers du train.
Il est bien d’autres griefs, et de plus sérieux, à faire valoir contre l’automobile. La voiture et le camion sont des moyens de transports extrêmement nuisibles et meurtriers. On aimerait pouvoir écrire excessivement, mais on ne ferait qu’exprimer un sentiment minoritaire, puisqu’aussi bien la société s’accommode sans le juger exorbitant d’un tribut annuel de milliers de cadavres.
Membre d’un parti arrivé au pouvoir en promettant rien moins que de « changer la vie », Paul Quilès se bornait piteusement quatre ans plus tard à fixer le seuil de la tolérance de gauche en matière d’hécatombe routière : « Nous voulons ramener très vite autour de 10 000 le nombre annuel de tués[15]. » Rendons cette justice au socialisme parlementaire que lorsqu’il abandonne ses utopies fondatrices et s’assume pour ce qu’il est désormais, je veux dire la voiture-balai du capitalisme, il peut se fixer des objectifs réalistes et les atteindre ! Le nombre annuel de tués sur les routes se situe bien « autour » de 10 000, chiffre auquel on aura soin toutefois d’ajouter, outre plusieurs centaines de milliers de blessés, 2 000 à 2 500 décès survenus plus de six jours après l’accident, et que les statistiques ne prennent pas en compte.
La route, l’autoroute surtout, détruisent aussi l’environnement. L’emprise d’une autoroute est en moyenne de 10 hectares au kilomètre. Chaque kilomètre reçoit annuellement 73 tonnes de poussières, 146 kg de plomb, 54 kg de zinc et 2,5 tonnes d’hydrocarbures. Quant au sel utilisé en hiver, il tue 600 000 arbres par an sur le réseau routier européen[16].
Hécatombe humaine, désastre écologique, tout cela n’entame nullement la détermination des gouvernements successifs qui privilégient le transport par route. Grâce au TGV, la SNCF se débarrasse non seulement des lignes et gares déficitaires pour le trafic voyageurs, mais aussi d’une grande partie du transport marchandises. En août 1991, L’Usine nouvelle évoquait la suppression, d’ici la fin 1994, de 1 300 gares de fret sur 3 880 existantes en 1987, et de 2 200 embranchements (tronçons connectant une usine au réseau ferré) sur 7 900. Ces fermetures se soldent soit par un déménagement de l’entreprise, soit par un transfert sur route. Ce transfert massif accroît l’usure du réseau routier (dont les camions sont responsables à 85 %), les risques d’accidents (les camions en provoquent 20 %) et de catastrophes écologiques, étant donné la nature des produits et déchets transportés.
Dans ce contexte, « jouer à fond le TGV contre la route », comme le propose René Dumont, est une formule vide de sens. L’écologiste, qui a poussé le ridicule jusqu’à se faire photographier aux commandes d’un « TGV », y est favorable « à 100 % » au motif que le train ne produit pas de gaz carbonique, contrairement à la voiture et à l’avion. Pas plus que l’Ami Samuel, Dumont ne s’inquiète de l’origine nucléaire de l’électricité consommé par le TGV : « Cela dit, tout le monde se souvient de Tchernobyl. Et puis que fait-on des déchets ? Malgré tout, si les Verts sont hostiles au nucléaire, j’avoue que moi je suis en train de réexaminer ma position[17]. »
Qu’un écologiste auto-proclamé traite Tchernobyl comme un mauvais souvenir et déclare s’être fait au nucléaire, comme on se surprend à fredonner une rengaine à la mode, voilà qui mérite d’être porté au crédit comique de notre époque. Plus sérieusement, on retiendra l’hymne de Dumont au TGV comme un bon exemple de ce « réalisme utopique » qui approuve un forfait dans l’espoir que ses auteurs sauront s’abstenir d’en commettre d’autres. Las ! les criminels de fonction ignorent, quand ils traitent leurs victimes, le préservatif du moindre mal ; entre deux maux, ils s’arrogent le droit de ne point choisir.
En matière de circulation, le comble de l’absurdité est atteint dans les grandes villes, à Paris surtout où la Mairie, les maires d’arrondissements et la préfecture de police jouent la voiture contre l’autobus et détruisent progressivement ce qui reste de la cité pour en faire une autoroute, doublée en sous-sol d’un immense parking. « Paris veut rouler ! » claironnent les affiches.
Reconnaissons que les embarras de la capitale, en progression annuelle de 4 %, donnent déjà à ceux qui en sont responsables des hallucinations monstrueuses. Le préfet Verbrugghe assure qu’« aujourd’hui, le Parisien n’a pas deux jambes mais quatre roues. C’est comme ça. Alors il faut qu’il puisse bouger avec ses roues[18]. » Que voit-il de lui-même, cet androïde, lorsqu’il se rase, une soupape ? un carburateur ? un parcmètre ? Et il faut qu’il pense avec ça ! Nécessairement, le produit de ses cogitations est à son image : ridicule et nuisible. Lorsqu’il se mêle de combattre la pollution atmosphérique, lui qui s’enivre des gaz d’échappement s’en prend aux arbres. Il est de ceux qui les font couper, au petit matin, sous la protection des CRS, à St-Merri et place du Tertre, mais il interdit aux boulangers de cuire le pain au feu de bois[19] !
L’économie, c’est-à-dire la vision économiste du monde, se nourrit d’incohérence et de mensonges. La politique des transports, tout orientée vers l’automobile, entraîne non seulement un coût humain — dont on ne s’étonne pas qu’il soit indifférent aux gouvernants —, mais encore un coût financier. Or, si d’aventure ce coût est évalué par les économistes, il est délibérément ignoré par les politiques. Le rapport Boulladon[20] estimait par exemple que le transport de marchandises par camions de fort tonnage, que le TGV vient renforcer, est déficitaire à 50 % ; le déficit est donc comblé par les contribuables. Le Comité français pour l’environnement évalue à 20 milliards de francs par an le coût du transport routier, chiffre auquel il convient d’ajouter 20 autres milliards pour pallier ou prévenir les effets de la pollution, et 15 milliards consacrés aux charges d’infrastructure[21].
La revue Auto-Moto, peu suspecte d’opposition maniaque à l’automobile, affirmait que les encombrements équivalaient, pour l’année 1989, à « 4 millions de journées de travail perdues, cinq fois plus que pour les conflits du travail. » La région parisienne totalise à elle seule « 300 000 heures de travail perdues par jour[22] ». Après tout, si la paix sociale est à ce prix ! Et en effet, il s’agit bien de cela ; renoncer à la production automobile ou même la réduire notablement amènerait, dans le système actuel, une augmentation du chômage que personne ne peut prendre le risque électoral d’assumer. Sans doute les outils statistiques ne sont-ils pas assez subtils pour départager, parmi les dix mille cadavres annuels, les actifs des chômeurs, les cadres des assistés du RMI.
Quand ce gâchis ne se paie pas de sang, il sombre dans le ridicule. « Une expérience faite (par Auto-Moto) un lundi de Pâques a montré qu’entre Le Bourget et Pantin (10 kilomètres) la plus moderne des voitures françaises bat péniblement une Delaunay Belleville de 1911 et prend seulement un quart d’heure à un char romain attelé à deux chevaux. »
Du train où vont les choses
Techniquement, la grande vitesse n’exclut pas une desserte harmonieuse du territoire, ainsi que le montre l’exemple japonais (cf. Annexe). Mais la question n’est pas là, il est clair que la SNCF se souciait comme d’une guigne de faire rouler les trains plus vite ou d’améliorer les conditions de transport ; elle entendait reconsidérer sa stratégie d’entreprise. Dans la perspective d’une rentabilisation de son monopole, le TGV était inéluctable.
En effet, en matière de vitesse le chemin de fer ne pouvait concurrencer ni la voiture (mais tout le monde s’en moque) ni l’avion. Si le TGV le peut, lui, c’est parce qu’il n’a rien de commun avec le train classique, dont il annonce et précipite la fin.
Pour mettre au service du plus grand nombre un moyen de transport plus sûr et — localement — moins polluant que l’automobile, il eût fallu faire un double choix politique : la gratuité[23], et le renforcement du réseau ferré régional. C’est l’inverse que l’on commet.
En fait de mobilité, le TGV va figer dans le paysage français — et pour longtemps — une conception du territoire et de la circulation entièrement dominée par la marchandise. Ce qui s’est réellement accéléré dans le monde, c’est la mort (Exocet), le mensonge (CNN), et l’argent (cartes bancaires). Le reste est faux mouvement et illusion d’optique.
Si le TGV constitue une cible obligée et privilégiée, c’est qu’il concentre une bonne part des simulacres de notre époque, dont les conséquences matérielles affectent la vie quotidienne de millions de gens. Incarnation supposée du Progrès, il en illustre le mécanisme : une absurde fuite en avant.
Il importe au contraire de ne pas faire ce qui est techniquement réalisable lorsque cela est inutile et nuisible. Il sera bon d’interdire aux ingénieurs de faire rouler les trains à Mach 2 s’ils en trouvent le moyen, aux généticiens de fabriquer en éprouvette des bébés hermaphrodites, comme il eût été préférable de ne pas fabriquer d’uranium enrichi.
Dans ce monde, où les actes élémentaires nécessaires à la survie, manger, boire, et même un mouvement réflexe comme la respiration deviennent des gestes mortels, par surcroît la « communication » se dégrade au fur et à mesure que se multiplient les moyens techniques censés la favoriser. De la disparition de l’écouteur sur les combinés téléphoniques jusqu’au démantèlement du réseau ferroviaire, tout y concourt. La vie devient toujours plus difficile pour les pauvres, et toujours plus pauvre pour tous.
Même s’il s’avère impossible d’empêcher l’achèvement du projet TGV, tout ce qui peut être sauvé de ce qu’il détruit mérite de l’être. Au moins importait-il de réunir les preuves suffisantes de ce que le TGV, ajouté à tant d’autres nuisances, suppose de mépris pour les hommes et pour la planète qui les porte. Tant mieux, d’ailleurs, s’il peut ici et là cristalliser et fédérer des révoltes éparses.
Le communiste Bordiga souhaitait que l’humanité puisse se débarrasser de tous les objets nuisibles, « du porte-avion au fume-cigarette ». Le TGV vient grossir la liste.

[1] Cité par J. -F. Bazin in Le Monde, 7 novembre 1990.
[2] Bien entendu, les système RESA puis « Socrate » (augmentations de prix et division par deux du nombre de places) sont appliqués sans vergogne aux « TGV » qui circulent à la même vitesse que les Corails.
[3] Le Monde, 14 décembre 1990. Un mois plus tôt, le directeur commercial « voyageurs » de la société assurait que « la SNCF perd des recettes (sic) avec la pagaille actuelle. Il faut qu’une réservation ne soit valable que pour un TGV donné » ; Le Monde, 6 novembre 1990.
[4] Le Monde, 20 décembre 1990.
[5] La Vie du Rail, 5 au 11 octobre 1990.
[6] CET de Lyon, op. cit., p. 513.
[7] J’écarte un train de nuit (départ à 23 h 35) circulant les vendredi du 30 juin au 25 août 1989. Il en sera question plus loin.
[8] Document de la CGT Rennes-Paris, Montaparnasse-Nantes, 14 mai 1988.
[9] Conférence de presse des Comités de défense des dessertes ferroviaires de Bretagne, Club de la presse de Rennes, 11 juillet 1979.
[10] Ouest-France, 2-3-4 juin 1990.
[11] Le Télégramme de Brest, 13 décembre 1979.
[12] Ouest-France, 19 novembre 1979.
[13] Rapport d’étape, juillet 1990, p. 19.
[14] Le Monde, 15-16 septembre 1991.
[15] Le Monde, 23-24 juin 1985.
[16] Le Monde, 6 septembre 1990.
[17] La Vie du Rail, 19 au 25 septembre 1991.
[18] Le Monde, 27 avril 1990.
[19] Le Monde, 5-6 janvier 1992.
[20] Cité in Le Point, 2 juin 1979.
[21] La Vie du Rail, 23 au 29 janvier 1992.
[22] Auto-Moto, mai 1991, cité in FNAUT-infos, n° 5, octobre 1991.
[23] Seuls les étudiants et lycéens de province retrouvent — à la veille des grandes manifestations parisiennes — le sens du service public en exigeant des trains gratuits pour s’y rendre.