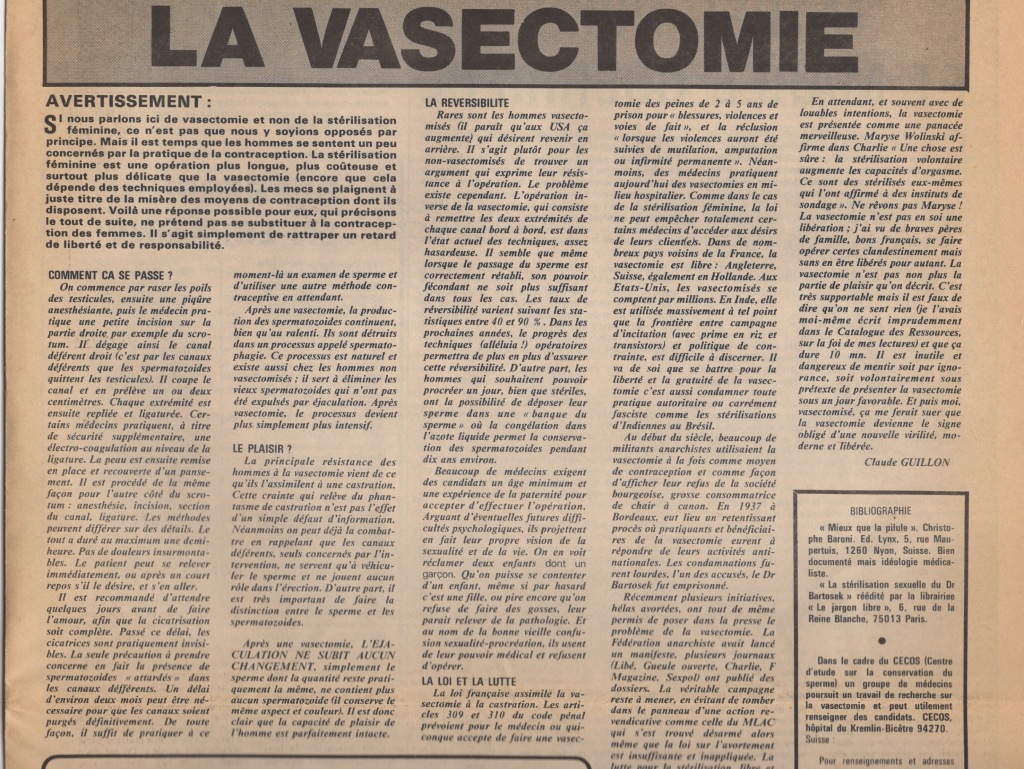Le corps critique
Pas de hiérarchie entre les souffrances !
Une chose m’a frappé, à la lecture des dizaines de messages de sympathie reçus après l’annonce de mon opération et de mon état peu brillant, c’est le nombre d’ami·e·s qui font allusion à leurs ennuis de santé récents – qui une opération d’un cancer du sein, qui une hospitalisation, etc. – mais ajoutent aussitôt une formule du type : « Mais évidemment c’est sans rapport avec ce que tu subis ! »
Bien entendu, il ne s’agit pas de nier une hiérarchie de fait entre les souffrances. Par leur intensité d’abord – « Entre 2 et 10 ? ne cesse-t-on de vous demander à l’hôpital, et c’est un véritable progrès ! –, par leurs conséquences matérielles ensuite : mieux vaut se tirer vivant·e d’un accident de voiture, avec ses deux yeux, ses deux bras et ses deux jambes, plutôt que…
Cependant, il m’a semblé que les ami·e·s en question disqualifiaient leurs propres expériences, tout en y voyant la preuve de notre commune appartenance à l’humanité (nous souffrons et nous mourrons).
Mes très chèr·e·s ami·e·s, je crois sincèrement que la différence majeure entre nous est que, contrairement à la quasi-totalité d’entre vous, je dispose d’un blogue où je peux m’exprimer à ma guise, et faire connaître ma situation urbi et orbi si et quand je le juge bon.
Je ne crois pas une seconde que votre souffrance vaille moins que la mienne, dès lors qu’elle a perturbé votre vie, vous a plongé – vous et vos proches – dans l’inquiétude, la trouille de la douleur (piqûre, chirurgie, effets secondaires des médicaments), et l’angoisse de la mort (et chacun·e sait qu’il n’en faut pas beaucoup). On pourrait en dire autant de la souffrance des enfants ou des proches.
Au-delà des petits accidents de la vie quotidienne (je me coupe souvent les doigts avec des feuilles de papier !) toute affection chronique ou aiguë qui vient nous rappeler à notre condition de mortel·les nous secoue, nous bouleverse. Plus ou moins sans doute, selon les caractères ou les moments de la vie.
Le sentiment de notre finitude (connue mais tenue à distance) peut se contrôler intellectuellement – après tout, c’est une des fonctions principales de la philosophie – mais lorsque notre corps nous y ramène, plus ou moins délicatement, comment ne pas éprouver un sentiment de panique.
L’expérience de l’hospitalisation est à cet égard singulière. Si l’on m’autorise une métaphore d’origine religieuse, je dirais qu’on s’y trouve, en attente, comme au purgatoire. C’est une fausse vie : la vraie, celle que l’on aperçoit au dehors, si l’on a la chance de se mouvoir, on n’est pas certain·e de la réintégrer un jour. Il y a certes de l’humanité, des échanges, avec le personnel, d’autres malades, mais chacun·e n’attend que de rentrer chez soi pour y pouvoir vérifier que la vraie vie continue.
Qu’elle continue donc, aussi passionnante que possible, et rendue possible par l’amour, l’amitié et la solidarité.
Soyons attentifs et pleins de compassion les un·e·s pour les autres, sans chercher à savoir qui a le plus mal.
Mettre de la hiérarchie dans nos souffrances ne ferait qu’ajouter de la souffrance à la souffrance. Nous avons mieux (et pire !) à faire.
Mille baisers à toutes et à tous.
Et surtout, la santé ! Paris, le 12 janvier 2022
Avertissement
Ce texte, j’en avertis ami·e·s et lectorat lointain, recoupe certaines informations déjà diffusées par mails à des proches ou plus largement sur Twitter. Sans fausse modestie, il n’a aucune prétention à l’originalité : il s’agit simplement pour moi de faire un point à un moment de ma vie où j’ai failli passer – mais définitivement cette fois – l’arme à gauche…
Je ne publierai pas, sauf nécessité particulière de nouveaux textes ; il vous faudra vous reporter à cette page pour voir s’il y a des ajouts, portés à la suite du texte d’aujourd’hui. [À la réflexion, il est plus simple pour moi, et sans doute pour tout le monde, de mettre en ligne de nouveaux «bulletins de santé».] Je suis désolé pour ce que cette forme de communication peut sembler avoir d’impersonnelle, mais je suis contraint d’économiser mes forces. Merci si vous pouvez le comprendre et l’admettre (sinon, je ne vous en veux pas ; je sais comme la maladie et la mort sont anxiogènes).
Il peut s’être glissé une inexactitude technique médicale dans mon témoignage : je suis soumis à la double contrainte du « non-spécialiste » qui essaye d’être compris de gens qui le sont encore moins que lui (et je leur souhaite que ça dure).
Le corps critique
J’avais, à l’époque de l’Assemblée de Montreuil (cherchez cette expression pour les ignorant·es ; ceci écrit sans mépris), diffusé un texte sur les effets de ma maladie de la moelle osseuse sur ma vie quotidienne et donc aussi sur mon activité militante (Et vous, ça va ?). Rien à voir avec la pseudo « transparence », toujours démentie, des hommes d’État. Mais à quoi bon publier (2008) un livre intitulé Je chante le corps critique sur les « usages politiques du corps », et n’en rien dire quand « il me lâche » – certainement une très mauvaise façon d’exprimer la chose, mais ainsi est-elle vécue.
Bref rappel. Je suis atteint depuis plus de quinze ans d’une maladie de la moelle osseuse – étrange organe qui fabrique le sang (à ne pas confondre avec la moelle épinière) – dite polyglobulie de Vaquez. Maladie faite pour l’angoissé que j’ai toujours été, puisqu’elle consiste littéralement à « se faire du mauvais sang » (trop chargé en globules rouges). J’ai été longtemps soigné par une combinaison de chimiothérapie au long cours et de saignées. Ce traitement contrôlait (imparfaitement) la maladie, et n’en traitait pas l’un des pires symptômes (quoique non mortel) : le prurit à l’eau. Soit, en période aiguë sans traitement de contrôle, des crises de démangeaison à rendre fou, et avec traitement (puvathérapie à l’hôpital + antidépresseur au pouvoir antihistaminique) 20 mn de démangeaison après chaque douche, voire demi-douche (on apprend vite à s’entourer les jambes de sacs poubelles pour leur épargner l’eau…). Ajouter la crainte des rayons surgelés des supermarchés et celle des orages, qui vous plaquent le pantalon sur les mollets. Bien sûr : renoncement à la natation (je n’aime pas ce mot ; j’aime être immergé dans la mer, m’y mouvoir avec les oiseaux plongeurs).
J’ai fait un long essai de 18 mois à l’Interféron, principalement utilisé dans les hépatites (traitement moyen : 4 mois) ; il agit dans 50% des cas de ma maladie ; pas dans le mien. J’en suis sorti épuisé par un régime d’horreur sur lequel je n’ai pas envie de revenir. Certes, durant cette période, j’ai néanmoins rédigé deux livres (commandés l’un par les éditions Libertalia, ce dont je leur sais gré, quelques soient nos éloignements et conflits d’aujourd’hui, et par Benoit Maurer (Imho), aujourd’hui mon principal éditeur). J’ai aussi fait deux rencontres amoureuses. J’étais plus jeune… et la perspective d’une guérison ou d’une simple rémission me tirait vers l’avant·l’avenir.
Quasi-miracle, vécu comme tel, une nouvelle molécule, le Jakavi, prescrit il y a quelques années (cinq ? j’ai la flemme de vérifier) « efface » le prurit en l’espace de quatre jours. À moi douches, ablutions (dont je suis friand) et longues baignades en méditerranée (d’où mon achat il y a deux ans d’un appartement à Marseille).
Mais un effet secondaire du précédent traitement est encore aggravé par le Jakavi : apparition de tumeurs cancéreuses dites « bénignes » sur la peau, du visage notamment. Tumeurs plus agressives, plus profondes, plus difficiles à opérer et dont la cicatrisation est plus laborieuse. Longs cycles d’opérations et de soins infirmiers quotidiens, très contraignants (surtout pour un douillet, qui n’a jamais – je le glisse ici – supporté la vue du sang et pour lequel une prise de sang [pour ne rien dire d’une saignée] demeure une corvée, après près de vingt ans de pratique intensive).
À la rentrée 2021-2022, souci supplémentaire (outre une sinusite) : une espèce de ganglion sous l’oreille gauche, qui se révèle au scanner et après une triple biopsie être une triple tumeur organisée autour de la glande parotide (salivaire). Période pénible ; zone très douloureuse ; impossibilité de dormir ; angoisse. Je perds du poids, mon hémoglobine (à vos dicos !) baisse et la « communication » avec mon hématologue, chaotique, est sans effet concret. Je finis par devoir recourir aux relations d’une amie médecin, qui me trouve en quelques heures, depuis une ville de province, le contact avec un chirurgien ORL parisien qui, lui-même, me propose trois rendez-vous possibles dans les jours qui suivent. Je choisis le plus proche ; le médecin me prescrit un scanner du corps entier (celui prescrit précédemment par mon hémato concernait la tête et le cou), pour repérer d’éventuels « échos » de la tumeur (il ne semble pas y en avoir). La triple biopsie (« carottages » effectuée dans les tumeurs confirme le caractère tumoral ; rien à voir avec un banal ganglion). De plus, il existe une hypothèse d’un lien avec deux tumeurs de la pommette gauche. Je ne suis pas en mesure de dire à la minute où j’écris ce texte si cette hypothèse est confirmée ou non ; je n’ai pas forcément ni tout compris ni tout retenu, et je dois revoir mon chirurgien lundi prochain pour faire un point. L’hypothèse est évidemment catastrophique, puisqu’en gros, et pour le non-spécialiste que je suis, elle signifie que des tumeurs de surface peuvent bel et bien métastaser, acquérant un caractère « malin » dont on se serait passé. (Ou, ce qui revient presque au même, que des tumeurs malignes peuvent apparaître n’importe où, mais est-ce en relation avec le traitement ? Il est trop tôt pour le dire.)
Le chirurgien, qui m’a reçu très vite et m’a trouvé très vite scanner complet et biopsies me propose de m’opérer avec en gros une semaine d’avance sur le calendrier initialement prévu par lui. Non seulement le garçon est rapide, mais il arrive à se devancer lui-même !
J’entre à Lariboisière le 4 au (petit) matin ; pas de souci, je ne dors pas.
Je passe vite sur les difficultés administratives que connaissent tous les hôpitaux du fait du variant nouveau du Covid : on a fermé des services, dont celui qui devait m’accueillir, mais je n’en suis pas informé ; je me heurte donc à une porte close à un étage désert (brrr ! à 7h 30 du mat, déjà terrifié de venir sur vos deux jambes vous faire découper en morceaux…) ; je vais passer utilement mon temps aux admissions ; je reviens dans le même service : miracle ! une dame est là, qui me dirige vers le bon service, que je finis par trouver (déjà un peu plus mort que vif ; je suis un héros tout relatif, j’en conviens sans baragouiner).
L’opération se déroule d’abord plutôt bien, mais hélas je fais une hémorragie consécutive qui nécessite une « reprise » (en terme technique), autrement dit une seconde opération immédiate pour vider un hématome et cautériser des vaisseaux susceptibles de saigner inopinément…
Je sors laminé de deux anesthésies générales (AG !) consécutives.
L’usage (efficace) de morphine pour contrôler la douleur avant l’opération a interrompu la fonction digestive. Les AG n’arrangent rien.
La double AG suscite, jusqu’à mon retour chez moi deux types d’hallucinations. Visuelles « externes » : je vois la lumière d’un néon ou la peinture d’une porte se détacher en filaments, qui se dirigent vers moi ; le tissu du drap se met à « bourgeonner ». Visuelles « internes » : dès que je ferme les yeux, se met en marche, sur un rythme effréné, une espèce de film d’animation à base de figures géométriques, aux couleurs très vives (rouge, noir, rouge), qui se transforment en personnages de BD fantastique pour se livrer des combats dantesques… Ça ne s’arrête que quand je rouvre les yeux. Impossible, donc, au sens propre, de fermer l’œil. Nostalgie cependant de créations d’une très grande beauté, dont je ne pourrais, même avec d’immenses efforts et l’assistance de spécialistes, donner même une vague impression.
S’est ainsi trouvée confirmée – dans une répulsion fascinée – ma radicale aversion à toute modification d’état de conscience, et aux drogues devant les provoquer (au-delà de la bière ambrée, du Vacqueyras et du Pouilly fumé [liste partielle]).
Dis-moi mon beau miroir ?
Me voilà de retour, depuis le 7, dans un appartement conçu comme une cabine de pilotage pour un seul navigateur, peu confortable, mal chauffé, toutes choses auxquelles je n’attache ni importance ni même attention en temps « normal ». (Je suis d’autant plus touché de resonger que beaucoup de mes amies·amours aiment cet appartement, s’y sont trouvées bien, « comme chez moi » m’a dit un jour N. Faut-il qu’elles aient de la tendresse pour le navigateur !… Il est vrai qu’il est aussi charmant, lumineux (mais torride l’été et glacial l’hiver), et enluminé de livres…)
Mon chauffage de salle de bain m’avait lâché quelques jours avant mon hospitalisation : excellent timing ! Grâce à Y., il va être remplacé sous peu.
Je n’ai garde d’oublier les six étages sans ascenseur, excellent préservatif du cœur (« et de tout l’restant ») en temps « normal » ; difficulté insurmontable sans l’amical et ferme soutien du bras de l’ami Y. au retour de l’hôpital, sortie rendue possible uniquement grâce à l’aide – et au déplacement tout exprès de N., qui m’avait déjà fourni le contact du chirurgien.
Comme quoi, prolonger en amitié un amour, outre que c’est une des joies et des fiertés de la (ma) vie, peut aussi vous la sauver…
Quelle gueule t’as ?
Extérieurement : visage légèrement de guingois, lèvre·machoire inférieure décalée, d’où outre l’esthétique une difficulté d’articulé, nuisible à l’élocution et à la mastication.
Deux (gros) cratères sur la pommette gauche (deux tumeurs « de surface » opérées), mais ça va cicatriser (lentement).
Une cicatrice assez hideuse (mon chirurgien n’en prenne ombrage !) qui part de derrière l’oreille gauche pour aller jusque sur le devant du cou. Pour faire un clin d’œil à mes ami·e·s dixhuitiémistes, je dirai que l’impression immédiate est que l’on m’a – à moitié seulement – guillotiné…
Je reçois une infirmière chaque jour pour changer les pansements, suivre l’évolution de la grosse cicatrice, etc.
Je peux me doucher – seul, depuis hier – marcher (très) doucement. Je suis même descendu pour la première fois hier midi acheter à manger. On comprend que la difficulté consiste à remonter les six étages ; mais ça s’est plutôt bien passé et c’est un exercice indispensable. (Depuis mon retour de Marseille en octobre, j’ai perdu 9,2 kilos ; il faut à la fois me remplumer et glisser quelques muscles sous le plumage).
J’ai également, depuis avant-hier, repris (très prudemment !) le vélo d’intérieur. Je n’ai pas de souci de vertige ou d’équilibre.
Je marche très lentement dehors, avec une canne (retrouvée avec émotion : je l’avais achetée en 1996, après m’être fait éclater le foie par un porc en civil ; et là je souffrais de pertes d’équilibre ; je m’en suis resservie depuis lors de cicatrisations difficiles de plaies au pieds ou à la jambe).
Le pire, peut-être, ma voie de crooner (« Eh ! crâneur !… ») transformée pour longtemps en un croassement fort disgracieux et difficilement audible (par ex. pour mon vieux père, au téléphone). [Rectification du 17 janvier] Ça n’est pas, comme je l’avais d’abord compris, une corde vocale qui a été lésée mais le nerf qui lui est associé; d’où perspective de récupération, bonne si pas totale, de la voix après rééducation en orthophonie.
Autre rééducation à prévoir, en kiné, pour le bras gauche (le « mauvais » côté : la Bible le disait déjà !) que je ne peux élever à 45°, qui me fait mal, comme l’épaule, et me trahit lors de divers mouvements. Ça se récupèrera.
Je l’ai dit, j’ai du mal à mâcher, mais aussi à déglutir, à me racler la gorge, à expectorer et à cracher (la salive subsiste, la glande parotide gauche n’ayant pas été complètement retirée). Bailler et éternuer sont aussi des entreprises difficiles. Tous ces gestes, indispensables, ne sont pas aussi « innés » que nous le croyons (j’ai évoqué cela dans Je chante le corps critique). Petits inconforts combinés qui m’interdisent, entre autres, la station couchée (j’ai le sentiment d’étouffer). Je passe donc la nuit « assis·vautré » dans mon (excellent) lit, sans pouvoir encore trouver un sommeil de qualité. J’ai passé une partie de la soirée d’hier à tousser (peut-être résultat de mes efforts pour me faire comprendre de mon père), mais j’ai finalement, au petit matin, réussi à m’étendre. À force de me moucher et de de me racler la gorge, j’ai réveillé une petite hémorragie nasale, un vaisseau qui lâche quand il est trop sollicité : en fait de vaisseau, ce corps prend l’eau, dès que je colmate une brèche, une autre s’ouvre…
L’avenir
Immédiat : suites de l’opération, sur lesquelles j’en saurais davantage après le RV de lundi prochain, autrement dit : rayons, et probablement chimiothérapie.
À moyen terme : il faudra reconsidérer entièrement mon mode de traitement (arrêt du Jakavi ? mais il n’existe guère d’alternative ; retour à l’Interféron ? mais nooooon !) et établir une coordination entre médecins de spécialités (et peut-être d’établissements) différents, dont aucune base n’existe aujourd’hui. Un joli et ambitieux chantier en perspective… façon polie de m’exprimer. Mais le moyen de faire autrement ? Nécessité vitale.
Le travail et la vie
Contrairement à mes craintes du premier jour, trop vite exprimées sur Twitter – dans un appel paniqué aux manifestations d’amitié et de gentillesse, et mille merci vraiment à tous ceux et toutes celles, parfois simples « suiveurs mutuels » ou camarades inconnu·e·s, qui se sont manifesté·e·s, (toujours attendre quelques jours après la résurrection pour prendre des décisions !) je suis moins limité que je ne le craignais dans mon activité intellectuelle « banale ».
Je peux lire un texte sérieux, même si la lecture sur écran reste très fatigante.
Je n’en suis évidemment pas à me remettre à mon (monumental) bouquin sur les clubs de femmes pendant la Révolution, ou à quelque travail d’ampleur que ce soit (clin d’œil et bon signe, je pense : j’ai réussi à retrouver hier, dans un temps très acceptable et pour tout dire habituel [40 mn] un livre d’Arlette Farge dont j’avais besoin et que j’étais certain de posséder [Oui !]).
Les choses ne sauraient être exactement « comme avant », pas plus que je ne le serai moi-même.
Il me faudra du temps pour me remettre vraiment au travail – y compris avec de nouvelles périodes difficiles, liées par exemple aux rayons et à la chimio, puis au retour à des interventions plus « bénignes », mais dont je dois dire que je les appréhende infiniment, à la seconde où je vous écris.
Après être passé très près du gouffre – et en l’état de mes informations actuelles sur l’évolution des choses – ma survie n’est plus en cause.
Cependant, certaines affaires devront être hâtées (ou menées de manière autre que prévue jusqu’ici : je pense à la résolution du conflit avec mes anciens éditeurs de Libertalia, dont il est prévu qu’ils vont me racheter mes parts de la SCI propriétaire du local·librairie, ce qui fera d’eux les seuls propriétaires et maîtres avant dieu [qui n’existe pas]. Ils devront trouver les mots pour convaincre leur banquière qu’elle a tout intérêt à les aider à pérenniser la librairie, qui rapporte davantage d’argent que les éditions.
Certains projets devront peut-être être revus à la baisse – je pense à certains livres – en termes de temps et de volume. Il est beaucoup trop tôt pour prendre des décisions dans ce domaine ; je n’ai même pas eu l’occasion d’une discussion avec l’ami Benoit Maurer, des Éditions Imho.
Devrait se faire comme prévu la réédition (au printemps ?) chez Imho d’un livre initialement publié chez Zulma. J’avais pu boucler l’essentiel du travail (de mon côté) avant mon hospitalisation. Je ne manquerai pas de vous soumettre à un matraquage publicitaire ad hoc le moment venu.
Je veux ajouter, avant d’en finir pour aujourd’hui (pour l’actualisation, se reporter à l’introduction de ce billet) que passer si près du « grand Rien » modifie aussi, inévitablement me semble-t-il, la vision de la vie, de ce qui y a de la valeur ou non. J’avais déjà vécu cela – comme un vrai bonheur compensatoire, d’ailleurs – après l’épisode hépatico-policier de 1996.
J’ai encore beaucoup de sanglots à « avaler » (c’est l’étymologie de sanglot, comme je viens de le découvrir, avec étonnement, dans le Petit Robert ; ça tombe mal, moi qui ai précisément du mal à avaler) : d’abord un peu niaisement sur mon sort (j’ai eu et j’ai encore très peur), avec reconnaissance et émotion aussi pour l’amour et l’amitié reçues – et je compte bien exploiter sans vergogne, dès que j’irai un peu mieux et que je ferai moins peur à voir, au moins le dixième de celles et ceux qui se sont offerts pour diverses corvées, accompagnements et gentillesses…
Trop de sanglots donc, pour avoir le recul nécessaire pour réfléchir utilement à ma situation.
Cependant, frôler la mort fournit (gracieusement, mais aux seuls survivants) un recul minimal. Il m’incite dès maintenant à revoir – sans haine, mais avec exigence – certains liens, certains comportements.
Il ne s’agit pas de « régler des comptes » plus aigrement que prévu (je pense à Libertalia), mais d’appliquer simplement un principe de survie à mes relations : militantes, amicales, affectueuses.
Je peux tout « comprendre » (vraiment !), mais je dois considérer que – ignorant comme chacun·e, mais disons avec un peu plus d’acuité qu’il y a un mois, le temps qui me reste – je n’ai plus de temps à perdre à « supporter » certaines choses, certains manquements.
Chacun·e devra, de manière plus impérative qu’auparavant, évaluer ce que vaut pour elle·lui ma fréquentation, aussi virtuelle soit-elle (le Covid a encore tout dégradé dans ce domaine).
De mon côté, je viendrai humblement (si l’on peut juste éviter la corde au cou, s’il vous plaît !) solliciter le pardon de certains emportements (un peu infantiles, comme ils le sont souvent) auprès de tel ou telle. Et c’est avec le violent espoir d’être reçu et absous (même si je comprends bien que mon désarroi présent est un sésame d’assez piètre apparence).
Chacun·e, je pense, se reconnaîtra. Les inquiets et inquiètes à tort n’ont qu’à se manifester : je suis dans une disposition au fond très amoureuse et clémente. Je fais juste un petit (mais nécessaire) « ménage », encore le mot est-il trop fort. Simplement, en de telles circonstances, et presque mécaniquement, on « se compte », on compte ses ami·e·s, on revoit ses priorités.
Merci à toutes celles et ceux qui ont été au bout de ce long pensum. Vous savez que vous pouvez me joindre par mail, au pire via le dialogue de ce site ou par message privé sur Twitter pour les suiveurs·suiveuses (j’encourage vivement les autres à s’y mettre : je « poste » sur Twitter, avec une grande économie de moyens, et très vite, une foule d’infos que je ne prends pas la peine de développer sur les blogs – y compris à mon propos. Je préfère éviter le téléphone en ce moment : c’est désagréable pour l’autre, et fatiguant pour moi.
Mille baisers !
Que la vie vous soit aussi douce et légère que possible, et que cette année nouvelle soit pour nous tous et toutes moins pourrie qu’elle ne s’annonce !
“Opération vasectomie. Histoire intime et politique d’une contraception au masculin” ~ par Élodie Serna
Histoire intime et politique d’une contraception au masculin.
Depuis un siècle, des hommes font le choix de la vasectomie. Louée pour ses prétendues vertus rajeunissantes par des médecins, prônée comme réponse à la question sociale par des eugénistes et des néomalthusiens, adoptée comme méthode de contraception clandestine par des anarchistes, la stérilisation masculine fait parler d’elle en Europe dès les années 1920. Grâce à la simplicité de sa technique, elle est envisagée après la Seconde Guerre mondiale comme une solution face à la peur d’une explosion de la population mondiale. En France, elle demeure longtemps une pratique quasi exclusive des milieux libertaires avant d’entrer enfin dans les cabinets médicaux.
La contraception masculine – notamment la vasectomie – suscite un intérêt croissant. Elle interroge la relation des hommes à la virilité ainsi que le partage des responsabilités contraceptives.
Mais au-delà des questions de genre, réintégrer la vasectomie dans l’histoire et l’actualité de la contraception permet de décaler le regard sur les enjeux politiques de la procréation. Et de poser une question toute simple: alors les gars, quand est-ce que vous vous y mettez?
L’autrice
Élodie Serna est docteure en histoire contemporaine. En 2018, elle a soutenu à l’université de Genève sa thèse préparée sous la direction de Sylvie Aprile et Sandrine Kott, Faire et défaire la virilité. Les stérilisations masculines volontaires en Europe dans l’entre-deux-guerres, à paraître en novembre 2021 aux Presses universitaires de Rennes (PUR). Chercheuse indépendante associée à l’université de Lille, elle poursuit ses travaux de recherche, notamment au croisement de l’histoire de la médecine et de la sexualité.
Le livre sera en librairies le 21 mai (préachat chez l’éditeur).
Statut de l’ouvrage: offert par l’autrice.
C’est lorsqu’un livre comme celui d’Élodie Serna paraît que l’on réalise qu’il n’existait rien sur le sujet qu’il traite. Or, même si nous sommes loin de la clandestinité et de l’opprobre des années 1930 – 10 000 hommes se font stériliser chaque année en France, depuis la loi de 2001 – la vasectomie demeure mal connue. Et que dire de son histoire médicale, et plus encore de son histoire politique!
Tout le monde a des «images» en tête, des associations d’idées: stérilisations forcées (féminines surtout) dans les régimes totalitaires et les démocraties (il s’agit de femmes pauvres et·ou déviantes); stérilisations encouragées par l’offre d’une prime (transistor ou réveil) en Inde… Mais combien, y compris dans les milieux libertaires connaissent l’histoire du véritable réseau européen qui s’est tissé, à partir de l’Autriche, pour permettre aux camarades qui le souhaitaient de se faire opérer. Son action donna pourtant lieu à force surveillance policière, poursuites et condamnations. Il se prolongea par la suite dans le mouvement des Jeunes libertaires où militèrent les ami·e·s Hellyette Bess, Marcel Viaud, André Bernard… C’est tout un pan de l’action anarchiste dans le domaine de la contraception masculine et·ou du refus d’enfanter, une histoire militante qui s’est interrompue pour l’essentiel au milieu des années 1970, qui est décrit ici pour la première fois.
La vasectomie s’inscrit aussi, depuis les mêmes années 70, dans une recherche associative (plutôt que relevant du militantisme politique) sur la contraception masculine. La relative facilité, au moins pour les pères de famille, d’accéder aujourd’hui à l’«opération vasectomie» fait d’autant mieux ressortir les assignations plus contraignantes à la reproduction dont les femmes font l’objet. L’autrice évoque d’ailleurs les relations nécessairement contradictoires, voire conflictuelles, que les féministes entretiennent avec les hommes partisans – et parfois exagérément fiers – de la vasectomie. De ce point de vue, on peut se féliciter que le sujet soit aujourd’hui (et enfin!) traité par une femme.
Le livre directement publié par Libertalia au format poche permettra aux militant·e·s et aux curieux et curieuses de se réapproprier une histoire mal connue et de s’informer sur une question située à l’exacte intersection de l’intime et du politique. Celles et ceux qui voudront approfondir l’étude du sujet, notamment resitué dans l’histoire de la médicalisation du corps et du sexe se reporteront avec profit au texte complet de la thèse d’Élodie Serna, qui sera publié en novembre prochain aux Presse universitaires de Rennes (PUR) et dont je signalerai la parution.
Claude Guillon
“L’indécence n’est pas là où l’on croit” ~ par des occupant·e·s du Théâtre de l’Union (Limoges)
“Corps” ~ par Yseult
Quand la théorie prends corps…
“Généalogie des corps de Donna Haraway” ~ par Nathalie Grandjean
Ce livre s’attache à entrelacer une lancinante question philosophique – ce que peut un corps, ses modalités et puissances insoupçonnées – et un enjeu féministe, la transmission du corpus d’une théoricienne, Donna Haraway, à travers les corps qu’elle déploie au fil de ses travaux. Une généalogie particulière, celle des corps de Donna Haraway, surgit de l’entrelacement de ces deux enjeux. Qu’est-ce qu’une généalogie? Je la conçois ici dans un double héritage, celle de Michel Foucault et celle de Françoise Collin. D’une part, je retiens de Foucault l’idée d’une enquête qui travaille à partir de la dispersion, de savoirs locaux et fragmentés et d’événements singuliers, «qui ne recherche pas simplement dans le passé la trace d’événements singuliers, mais qui pose la question de la possibilité des événements aujourd’hui: “elle dégagera de la contingence qui nous a fait être ce que nous sommes la possibilité de ne plus être, faire ou penser ce que nous sommes, faisons ou pensons”»(Revel, 2009: 61-62)». Je retiens de la méthode généalogique foucaldienne la possibilité d’interroger le passé à partir d’une question présente, pressante pour moi, celle des modalités et puissances des corps. Comme ce livre n’est pas un livre d’histoire mais un livre de philosophie féministe, je dirais qu’il s’agit en réalité d’un commentaire généalogique. Ce livre est en effet, pour partie, un commentaire, au sens où l’entend Foucault dans L’Ordre du Discours (1970). Il consiste en l’écriture d’un discours inédit à partir d’un discours premier, celui d’Haraway. Le décalage produit entre ces deux discours entraîne des effets particuliers. Le texte premier, permanent et surplombant, ouvre la possibilité infinie de parler, raconter, discuter, et dès lors de créer des commentaires inédits. Bien plus, dit Foucault, «le commentaire n’a pour rôle, quelles que soient les techniques mises en œuvre, que de dire enfin ce qui était silencieusement articulé là-bas» (1970 : 27). Le commentaire se niche dans un paradoxe: à la fois dire ce qui a déjà (et mieux) été dit et à la fois écrire, souligner, répéter ce qui n’avait pas été dit ou écrit de cette manière-là.
Télécharger ICI le texte intégral de l’introduction au format pdf.
Éditions de l’Université de Bruxelles, 226 p., 23 €.
Prendre en compte la «prostitution heureuse»… Mais certainement!
Une chroniqueuse du Journal officiel de tous les pouvoirs l’affirme : « Il faudrait écouter sans se draper dans une position morale les travailleuses sexuelles se disant libres et heureuses ». « Peut-on être prostituée et contente de l’être ? » interroge dans un style plus direct le titre de l’article. Si le style est direct, la question est purement rhétorique, puisque le chapeau du texte a déjà donné la réponse. C’est oui.

Évitons, comme on nous le recommande, de nous « draper » dans quelque posture que ce soit et voyons de quoi on nous parle. Il existerait des femmes (des hommes aussi probablement, je n’ai pas eu accès au texte) qui, se prostituant, s’estiment « libres et heureuses ». Cette réalité, très plausible, ne risque de choquer qu’en raison du tabou paradoxal qui pèse toujours sur la mal nommée « sexualité[1] », considérée comme activité séparée, indispensable à l’équilibre des mâles, vaguement répugnante chez les femelles ; un ressort des comportements humains et de l’économie, soit de manière directe (industrie de la pornographie, prostitution), soit de manière indirecte (messages publicitaires conçus comme des excitants érotiques).
Rappelons-nous que nous avons dédaigné tout « drapé », et que nous nous montrons dans la rude nudité d’une pensée critique qui affronte la réalité.
Ce que les expressions « travailleuses sexuelles » ou « travail du sexe » veulent induire dans notre esprit, c’est que la prostitution, c’est-à-dire le fait de vendre des actes sexuels et·ou de louer des orifices de son corps est un travail comme un autre. Aussi forte soit la tendance moderne du salariat à solliciter, voire à exiger des salarié·e·s un engagement total, à la fois corporel et émotionnel, je doute que la journée d’une employée de bureau puisse être considérée comme un équivalent exact de la nuit d’une escort girl. C’est sans doute dans les gestes prostitutionnels les plus frustes et les plus courants (fellation) que l’on peut trouver le rapprochement le plus convaincant avec la mécanisation tayloriste du travail[2].
Mais prenons plutôt le problème par l’autre bout (de la chaîne). Peut-on supposer qu’il existe, dans l’industrie de l’armement par exemple, des personnes qui s’épanouissent dans leur travail et se jugent « libres et heureuses » ? Sauf à se draper dans une morale abolitionniste du salariat, il faut reconnaître que c’est sans doute le cas. Peu importe ici les raisons de tels sentiments (salaires décents, postes épanouissants, proximité lieu de travail/logement, que sais-je…) et le jugement politique ou psychanalytique que nous pourrions porter sur eux. Le fait est : prenons-en acte.
L’existence de ce sentiment de liberté et de bonheur devrait-il nous faire réviser notre position à propos du devenir de l’industrie de l’armement dans un monde révolutionné ? Certainement pas. Et je précise : pas davantage si ce sentiment était unanime, et non très minoritaire, comme il l’est très probablement, autant chez les personnes prostituées que chez les salarié·e·s de l’armement.
Passé la période d’affrontement violent que suppose tout bouleversement social – et durant laquelle, la production d’armes automatiques peut se révéler utile – la fabrication de matériel militaire, d’armement – classique, chimique ou nucléaire – sera interrompu et les usines démantelées.
On peut parier que la plupart des personnes qui jugeaient s’épanouir dans ce type d’activité exploitée trouveront sans mal des activités libres plus passionnantes, et ce dès le début d’un bouleversement révolutionnaire. Il en va de même des personnes prostitué·e·s.
Cependant, concernant ces dernières, si certaines d’entre elles demeuraient attachées à leur activité « sexuelle », et compte tenu de l’inéluctable abolition de l’argent, on peut imaginer que leur savoir-faire (sans doute la source partielle de leur « fierté au travail ») trouverait un nouvel emploi auprès des personnes âgées ou disgraciées, ou encore des personnes souffrant d’un handicap, mental ou physique. C’est à peu près ce que prévoyait l’utopiste Charles Fourier sous le nom d’« angélicat ». Comme dans l’utopie fouriériste, les ex-prostituées seraient regardées avec faveur et leur rôle social apprécié à sa juste valeur (morale).
On voit que, de ce point de vue, les personnes prostituées conservent, dans une société libertaire, une valeur sociale bien supérieure à celle des anciens salariés de l’armement – au moins considérés sous ce seul jour.
Il est d’ailleurs bon d’ajouter que les luttes menées par les personnes prostituées – contre les tracasseries policières, par ex. – sont aussi légitimes et justifiées que celles menées par les travailleuses et travailleurs d’autres secteurs d’activité. Cependant aucune des luttes menées, quelle que soient la radicalité des moyens employés, ne constituera un « sauf-conduit » pour telle activité considérée dans sa forme antérieure à la révolution. Cela voudrait dire, sinon, que l’humanité est condamnée à exploiter des mines de charbon (…tant qu’il en reste).
On voit que, aussi déconcertante qu’elle puisse être, la révélation d’un sentiment de liberté et de bonheur chez certaines personnes prostituées ne s’oppose en rien à une perspective abolitionniste, qui ne vise pas telle ou telle activité (l’armement, la prostitution) mais l’ensemble du salariat, c’est-à-dire l’exploitation du travail, l’abstraction de la valeur et son vecteur l’argent.
Il se trouvera sans doute, y compris après la révolution, des hommes (et quelques femmes) pour chercher à poursuivre l’exploitation sexuelle des femmes, soit pour en tirer des bénéfices sexuels soit pour re·créer des systèmes de troc où les femmes re·deviennent des marchandises. Ces tentatives artisanales de proroger le système actuel de domination masculine – constitutif du capitalisme – seront combattues comme telles.

[1] Que j’oppose à « érotisme », partie intrinsèque de la culture humaine.
[2] Godard l’a représenté dans une scène de sexe à plusieurs personnages dans Sauve qui peut (la vie) [1980].
Corps social ~ Exercice
De ces deux parties de l’anatomie humaine, vous indiquerez de laquelle l’exhibition peut être qualifiée de «républicaine», et pourquoi.

Fig. 1

Fig. 2
«Je ne vois pas du tout où il veut en venir…»