Le comédien déclarait à L’Express, le 11 avril 2019 :
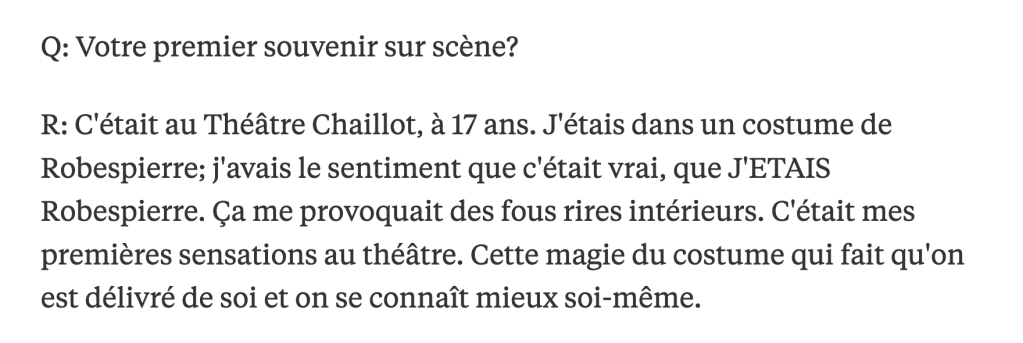
Ce texte a été écrit en février 2005 pour répondre à la question « Quelle révolution souhaitez vous ? » posée par une revue littéraire affichant un sympathique angélisme.
Mais il est arrivé au moment où ladite revue venait de décider de supprimer cette « rubrique » qui, sans doute, laissait perplexe la plupart des littérateurs actuels.
Il est donc resté inédit.
Le relisant en 2006, j’ai considéré qu’il n’avait rien perdu de sa pertinence et que, au prix de quelques légères améliorations, il méritait d’être livré au « public ». Ce qui a été fait sous forme d’une brochure aujourd’hui épuisée.
Un an plus tard, voyant l’état de la société, je me dis que le rediffuser via le media qui met Oaxaca à la porte de Bobigny (et « Big brother » dans tous les foyers !) n’est pas superflu.
Gérard De Mai.
1er mai 2007.
« Avec des cailloux, une sorte de boue, des arbres déchirés, et du sable fondu, on bâtit les palais de rêve. »
Scutenaire.
Évoquer l’idée d’une révolution quand pérore partout le cynisme câblé qui somme d’étouffer tout idéal sous la dérision, c’est fournir des verges pour se faire fouetter de sarcasmes. Qui vise, aujourd’hui, à remporter la « star ac’ » littéraire s’appliquera à fourbir de grinçantes caricatures des espoirs utopistes plutôt qu’à en fredonner la rengaine « démodée ». Et, qui refuse de s’inscrire à ce dépitant karaoké peut s’attendre à voir la machinerie spectaculaire s’appliquer à le ridiculiser pour défendre ses aveuglantes vessies cathodiques.
Il faut donc, pour parler sincèrement de révolution, partir d’un certain dégoût et même d’un écoeurement, d’une forte envie de « gerber ».
Qu’on ne se méprenne pas : Bien sûr, nous sourions et rions volontiers aux mises en scènes ironiques des velléités de changer le monde dans lesquelles notre jeunesse à généreusement donné, hier. La gravité est toujours l’armure des pédants et la sincérité répugne évidemment à l’endosser. Mais nous ne sommes pas stupides au point de ne pas voir que les ricanements désabusés, en « relativisant » tout ce qu’il y avait de généreux dans notre élan, prêtent la main à l’entreprise malsaine qui cherche à tuer cet élan par la bouffonnerie.
Après avoir bien ri de nos travers et de nos tics comiques, de nos outrances dogmatiques et de nos certitudes embrouillées, après avoir bien moqué les Saint Just de bistrot et les Guevara germanopratins, force est de constater que tout ce que nous avons voulu changer continue, et notre colère avec.
Il est grand temps de le dire : Nous en avons plus que mal soupé de ces désabusés confortables étalant leurs compromissions de caniches lécheurs dans toutes les antichambres du pouvoir, s’en parant comme d’une toge de « sagesse », apanage d’une « lucidité » qu’il faudrait admettre comme nécessairement désespérante. De « ce désespoir dont on fait vertu. Ce désespoir qui se boit ; se sirote à la terrasse des cafés ; s’édite… et ne demanderait qu’à nourrir très bien son homme[1] ».
Ce désespoir, trop rutilant pour être honnête, on sait qu’il peut, parfois, sans rougir, se faire nonchalamment complice des pires saloperies.
Alors, quel choix avons-nous ? Ricaner avec ça ? Ou dire que nous rêvons toujours d’un monde sur lequel ne régneraient pas la peur et le mensonge, la roublardise et la truanderie, l’oppression et la servitude, la misère et l’aliénation, la torture et les massacres guerriers.
Constatons le sans honte : Après déception des espoirs matinaux, la même envie reste à l’œuvre. L’envie de combattre ce despotisme qui, au nom du pognon roi, asservit les humains et ravage la planète. L’envie d’en finir avec le règne des tyrans, plus ou moins fardés de « démocratie ». L’envie de contribuer à faire une société plus sûrement vivable et agréable.
Certes, à regarder le monde tel qu’il est ces jours-ci, on s’attend plus à une explosion de toutes les barbaries qu’à l’avènement d’une « cité radieuse » (reléguant aux poubelles de l’urbanisme carcéral les bétonneries du Corbusier). On verrait plutôt, tout à l’heure, cette société sombrer dans son cloaque, s’étouffer des poisons qu’elle disperse à tous vents, s’étrangler dans les camisoles qu’elle passe à l’humain, mourir des haines qu’elle excite entre tous ses malheureux locataires.
Mais, alors même que tout invite au pessimisme, à commencer par les pénibles militants « révolutionnaires » engoncés dans leurs jargonneries indigestes et leurs incurables sectarismes, il faut répéter, avec Eduardo Galeano[2], que l’espoir fait vivre et peut même parfois faire gagner une vie meilleure pour peu qu’il s’accompagne de volonté.
À ceux, nombreux, qui m’objectent que le plaisir révolutionnaire a souvent été bref, et payé de grandes douleurs ; que les paradis des hommes libres, leurs collectivités, communes, soviets, n’ont jamais duré longtemps et ont toujours fini dans les affres, j’ai coutume de répondre que le Quilombo dos palmares, cette république d’esclaves s’étant libérés, a duré plus de cent ans, ce qui me semble déjà pas mal. Plus près de nous, les communautés zapatistes du Chiapas tiennent depuis plus de dix ans et certaines coopératives autogérées d’Argentine depuis quelques années. Mais aurait dit Istrati[3], un seul jour libre, c’est déjà mieux que toute une vie humiliée.
D’ailleurs, qu’importe si vouloir faire une révolution c’est essayer de labourer la mer[4]. Il n’est pas nécessaire d’être optimiste pour n’être pas du parti des requins, des hyènes et des cloportes. Il n’est pas nécessaire d’être l’archange Michel certain de terrasser le dragon pour être révolté par les crapuleries de nos califes et s’insurger contre leurs diktats.
L’envie de révolution se moque de tout calcul sur ses chances de succès. Elle ne suit pas un « plan de carrière ». Elle est le réflexe logique et sain de vouloir sortir du cachot, même si on doit y user toutes ses forces, même si c’est « utopique ». Elle est l’envie que le monde soit à la hauteur de nos rêves : Du pain et des roses sans mesure, le lait et le miel du paradis, sur terre, pour les vivants, nom de dieu !
De plus, ce n’est pas à nous qu’on fera le coup de l’impossible. Nous savons ce qui peut être. Nous l’avons vécu ce moment où la vie bouleverse tous les pronostics et ou l’élan des humains ressemble à la déferlante qui découvre sous les pavés la plage et redessine en un instant les contours du monde.
C’était un mois de mai… Vous avez dû en entendre parler. Nous avons vu, en un rien de temps, le peureux devenir audacieux, le crédule s’illuminer de lucidité, l’apathique soudain fougueux de volonté. Nous avons vu les tuniques de Nessus de la soumission jetées aux orties, les désirs se voulant réalité, les paralytiques se levant pour danser, mieux que dans la Bible car sur un rythme de rock endiablé. Nous avons vu des monstres changés en baudruches, des dinosaures transformés en libellules, et les poules ayant des dents, aussi charmantes qu’acérées.
Tout ce qui semblait immuable la veille était mis en question. La parole, émancipée de ceux qui habituellement l’accaparaient, ouvrait la porte à l’audace. Les mille débats spontanés qui agitaient les rues, les places et les bâtiments occupés réduisaient à néant le pouvoir hypnotique des saltimbanques de la politique et des ténors de la « pensée » servile, démontaient les carcans hiérarchiques et rôles sociaux qui maintiennent divisés et menottés. L’imagination osait se débrider avec l’impression que ça pouvait enfin servir. Les idées se frottant les unes aux autres allaient nourrir des gestes dont aucun Lénine n’aurait pu donner l’ordre. D’ailleurs, les professionnels de l’agitation militante erraient là dedans incrédules et complètement largués. « On ne renversait pas l’État, on le laissait tomber [5]. » . Dans les usines et les bureaux en grève, dans les écoles et dans les hôpitaux, dans les gares et les ports, dans les lieux « publics » repris par le public, on détricotait les mailles de l’ordre camisole et on commençait à construire une autre société, à réaliser l’utopie.
Par quelle bizarre alchimie en était on arrivé là ? Par ce mouvement qui prend toujours au dépourvu les despotes et leurs sbires : l’irruption soudaine, au grand jour, d’une révolte ayant longtemps mûri dans l’ombre. Pas un complot, non : l’explosion du « ras le bol » hors des galeries de la vieille taupe chère à un subversif d’antan (dont la barbe n’avait rien d’intégriste).
La bombe, chargée des humiliations mâchées et remâchées, des méfaits subis, des coups reçus, avait pété d’un seul coup en une émeute qui avait fait reculer les hordes matraqueuses de l’État. Et la barricade avait fermé la rue et ouvert « la voie ».
Et la joie, tranquille mais immense, de se sentir enfin maître de sa vie, responsable de ses actes et de leurs conséquences, « décideur » de son avenir, allait faire de ces jours ceux qui, de toute notre vie, nous sembleraient les plus beaux, et dont nous pleurerions la perte, au point même, pour certains, de ne pouvoir y survivre.
C’est d’ailleurs ce bonheur d’avoir pu jouir d’un tel orgasme de l’Histoire qui, plus encore que la peur qu’ils ont ressentie, est cause de la haine féroce que nous vouent nos ennemis depuis ce temps ; la cause de leur vindicte inextinguible.
Nous avons baisé avec l’éternité. Voilà ce qu’ils ne nous pardonneront jamais les petits hommes aux tristes pouvoirs. Voilà ce qui les a vexés et enragés contre nous, nos seigneurs chagrins. Voilà la cause de leur très bilieuse jalousie : Tous ces roublards au machiavélisme besogneux, tous ces Talleyrand aux bas de soie filés, tous ces fourbes tacticiens se rêvant Pharaons, tous ces tâcherons nabots se voulant Napoléon, finissent toujours, malgré leurs gesticulations fort médiatisées, par être contraints de se rendre compte qu’ils ne passent au guignol de l’Histoire que comme marionnettes interchangeables du show-biz démagogue, voués à être oubliés au rythme ou les peuples oublient les ministres, c’est-à-dire : plutôt vite. Ils doivent tôt ou tard encaisser la déplaisante évidence que leurs rêves de gloire s’achèveront au mieux en notules jamais consultées des manuels d’Histoire en marge desquels les écoliers gribouillent leurs rêves de grande récré. Et voilà qu’à nous, qui nous moquions de la postérité comme des mirages de la « réussite sociale » ; qui n’avions ni science ni goût de l’intrigue ; qui n’avions suivi aucune grande école de filouterie ni étudié l’art de l’arnaque politicarde, l’Histoire a ouvert grand ses bras, et le reste, « et le mois de mai ne reviendra jamais, d’aujourd’hui à la fin du monde du spectacle, sans qu’on se souvienne de nous [6] ».
Ils nous ont vaincus ensuite, c’est vrai. Et se sont empressés de reprendre et conforter le pouvoir qu’ils avaient momentanément perdu. Chaque jour leur joug se renforce en s’équipant de techniques « de pointe » d’autant plus efficaces qu’elles avancent grimées d’alibis démocrates et « libéraux ». Chaque jour, leur arrogance nous insulte un peu plus et se repaît de notre impuissance apparente.
Et nous nous sommes bronzé le cœur pour survivre dans cette jungle aux arbres à paillettes transgéniques où rôdent les prédateurs encravatés. Mais ils auront beau nous assommer de leur « réalisme » invitant à toutes les résignations, ils n’arriveront pas à nous convaincre que notre « utopie » avait tort. Nous avons touché sa réalisation possible. Nous avons tenu dans nos doigts cette félicité, fugace, mais suffisamment forte pour laisser à jamais son empreinte.
Nous nous souviendrons jusqu’à notre mort d’avoir vécu brièvement comme nous aurions voulu vivre toujours ; comme tous devraient pouvoir vivre toujours. Rien ne nous dissuadera de vouloir retrouver cela, ne serait-ce qu’un instant.
Nous sommes donc toujours prêts à embarquer sur la Santa Maria de la révolution, quelle qu’en soit l’apparente fragilité et l’hasardeuse destination.
Mais, quelle révolution ? Demandez vous. Eh bien, toujours la même, comme dit Burt Lancaster dans un délicieux western où les seins de Claudia Cardinale bombent l’écran : Les bons contre les méchants. Mais pas les bons « boys » du sultan Bush contre les méchants barbus d’Al-Caïda (ou vice-versa selon l’angle de tir). Non. Les méchants : ceux qui mentent, trompent, grugent, volent, asservissent, enchaînent, frappent, torturent, massacrent, détruisent, pour tirer un profit égoïste de leurs exactions. Les bons : ceux qui luttent contre tous les rapports qui avilissent l’humain ; ceux qui veulent une société de bien être et de plaisir pour tous, fondée sur la liberté de chacun.
« Mais c’est une vision grossièrement manichéenne ! » ne manqueront pas de hurler ceux qui aiment invoquer la « complexité » des relations humaines pour justifier leur résignation à l’ordure régnante. Oui. Mais si presque tous les humains ne sont réellement ni anges ni démons et vivent (comme le capitaine Haddock) constamment tiraillés entre ces deux tendances opposées, il n’en demeure pas moins vrai que leurs choix de s’orienter vers l’une ou l’autre manière d’être, vers l’un ou l’autre « parti », déterminent ce qu’ils vivent. Plus ils penchent d’un côté, moins ils risquent de tomber dans l’autre. Le grand philosophe La Palice n’est pas le seul à l’avoir constaté.
Quelle révolution ? Lambert et ses copains prennent leurs tracteurs pour aller porter à manger aux grévistes occupant l’usine de Sud-aviation ; Spartacus prête un glaive à Rosa Luxembourg ; Icarie s’installe en Catalogne ; Théroigne fesse Robespierre ; Rimbaud met la main au panier de Bretonw ; Varlet charge le chassepot de Varlin ; Bakounine pardonne à Marx ; Makhno chevauche avec Zapata ; Louise Michel offre une plume à Emma Goldman ; Pelloutier dépanne Mühsam ; Les conseils ouvriers de Budapest vengent ceux de Turin ; Pouget libère Sacco et Vanzetti ; Frantz Jung paye une chopine à Darien ; Khayyam trinque avec Sylvain Maréchal à la mort de tous les dieux ; Wei Jingsheng trinque avec La Boétie et Chalamov à la destruction de tous les cachots ; les portugais du 25 avril accrochent des œillets aux fusils crosse en l’air des lignards du 17 ème ; à Craonne on chante Le temps des cerises ; les Sans-terres serrent la pogne des Diggers et des Levellers ; les Aarchs de Kabylie reprennent l’exigence des Piqueteros d’Argentine : « Que se vayan todos » ; Solidarnosc salue Kronstadt en programmant la république autogérée ; à la Croix-Rousse les Canuts offrent à Autin-Grenier l’orchidée noire de l’anarchie[7] et Durruti l’en félicite ; à Moscou et à Londres on danse à l’annonce de la prise de La Bastille ; rue Gay Lussac, les seins de Marouchka dressent la plus ardente des barricades ; à Gênes Carlo Giuliani danse avec ses copains et copines sur les ruines du G8.
Quelle révolution ? Pas celle qui commencera demain. Pas celle du « grand soir ». Celle qui, parce qu’elle est la boussole de la vie quotidienne, rend l’existence plus exaltante.
« Si nous vivons, vivons pour marcher sur la tête des rois », ce précepte Shakespearien élogieusement salué par Debord n’est pas un programme pour l’avenir, mais le fondement d’un savoir-vivre quotidien. Non pas, certes, celui qui fait accéder aux palaces, sauf, rarement, au Palais d’Hiver ou aux Tuileries sous la mitraille. Non pas, non plus, celui qui rend la vie plus aisée. Mais celui qui mène loin des lieux où l’on rampe pour « s’élever » ; où il faut avaler des crapauds à longueur de journée pour trouver la vie supportable ; où l’on se contraint à « perdre sa vie à la gagner ».
C’est le principe qui met à l’abri de bien des soucis idiots et des compétitions stupides ; qui permet d’éviter bien des danses de canards se dandinant vers l’abattoir et bien d’autres « On à gaaaagné ! » vomitifs. C’est aussi le principe qui fait des amitiés fortes et des vies pleines, qui n’ont pas peur de se regarder dans la glace, même quand elles ont une gueule déglinguée par toutes les bacchanales et tous les deuils d’une existence.
Alors franchement, rien à foutre que la révolution ça ne soit pas très « tendance » !
Hasta l’Utopia ? Siempre !
Février 2005-Juillet 2006.
[1] Laure (Colette Peignot), « D’où viens tu ? », 1938, Reproduit dans Écrits, Change Errant, 1976.
[2] Eduardo Galeano, Sens dessus dessous, l’école du monde à l’envers, Homnisphères, 2004.
[3] Panaït Istrati, dont les œuvres viennent heureusement d’être rééditées en trois volumes par les éditions Phébus.
[4] « Celui qui sert une révolution laboure la mer », Simon Bolivar, Lettre à Juan José Florès, 9 novembre 1830, cité par Patrick Deville dans Pura Vida, Seuil, 2004.
[5] Tocqueville, Souvenirs (de la révolution de 1848), 1850
[6] Guy Debord, Film La société du spectacle, Œuvres cinématographiques complètes, Champ Libre, 1978.
[7] Lisez L’éternité est inutile, L’arpenteur, 2002.